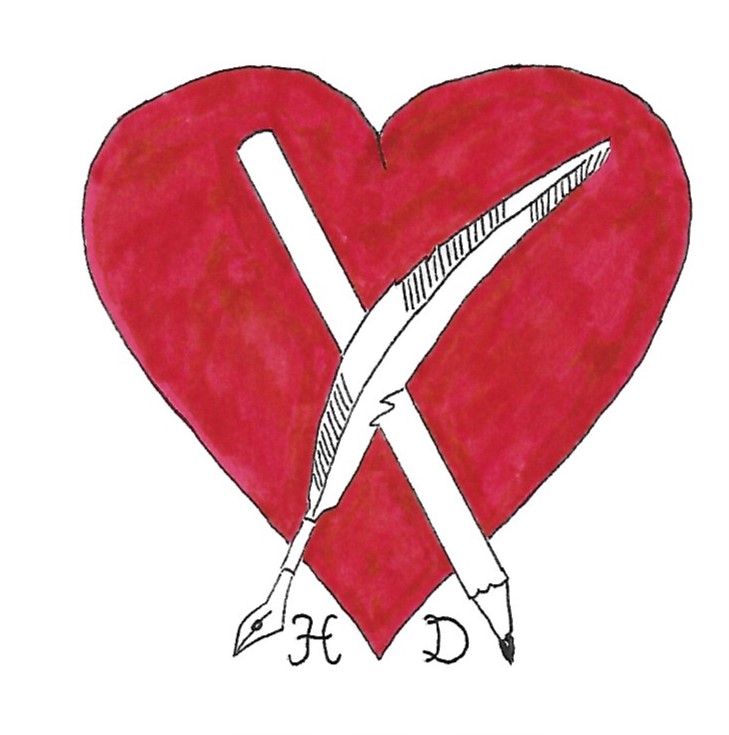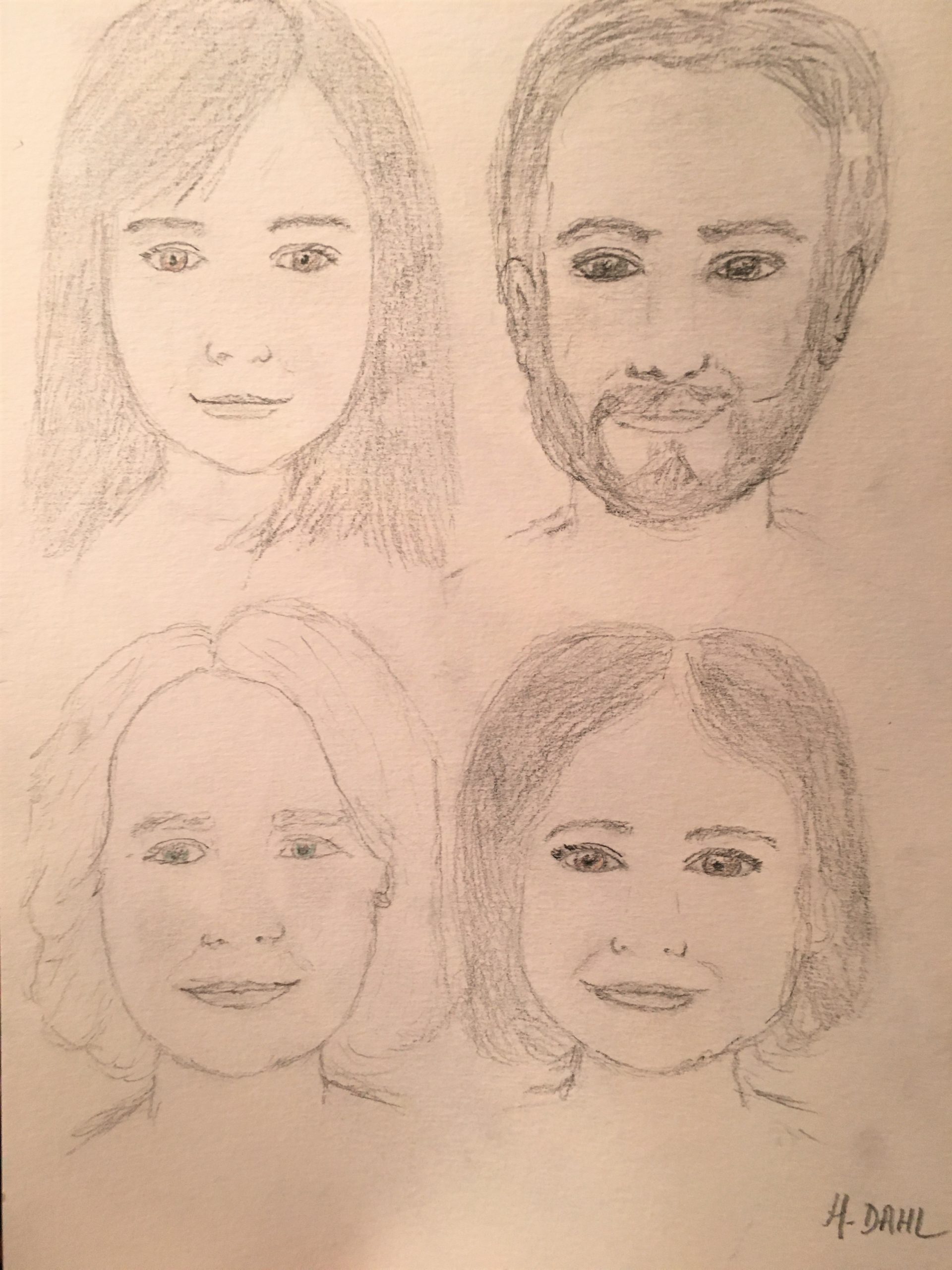
21 Déc À nous quatre

Dès que l’on franchit la frontière du soi, il est difficile de concilier les aspirations de chacun. Cela n’est pas donné à tout le monde d’aboutir à cet équilibre qui fait que l’on parvient à prendre sa place sans empiéter sur celle des autres. Savoir se positionner tout en restant à l’écoute, faire preuve de conciliation pour favoriser la réconciliation, agir pour le bien-être de celles et ceux qui comptent en se rappelant de prendre soin de soi et de ne pas s’effacer, appelle une détermination et une constance sans pareille.
Pour trouver sa place parmi les autres dans le respect de qui l’on est, pour maintenir l’intégrité de son noyau identitaire, il importe avant tout de ne pas se confondre avec qui que ce soit. Il s’agit d’un des enseignements les plus importants que j’ai tiré de mon expérience face à la dépression. La fusion de mon identité avec celles de mes proches a été nuisible à l’affirmation de mon être. D’abord et principalement vis-à-vis ma grande sœur.
Depuis la plus tendre enfance, nous étions fusionnelles. Je voulais faire comme elle, être comme elle. S’il me fallait choisir entre un après-midi à jouer avec elle ou avec les copines, je l’aurais choisie sans hésiter. Nous étions comme des partenaires de tango, inséparables, dépendantes l’une de l’autre, à tel point que nous nous suffisions à nous-mêmes. Ce qui supposait aussi que si l’une chutait, l’autre sombrait avec elle. Quand elle est tombée malade d’anorexie, mon monde s’est écroulé. À l’époque, j’avais douze ans et je me suis sentie abandonnée. J’ai vécu avec elle sa descente aux enfers jusqu’au moment où je me suis éloignée pour me protéger. Mon nouveau cercle identitaire, je l’ai trouvé dans mes amis. Incapable de me sentir bien avec moi-même, je pratiquais la fuite en avant. J’avais l’impression de ne pas avoir trouvé ma place dans ma famille alors, faute de la chercher en moi-même, je papillonnais ailleurs.
C’est toute la problématique des enfants dont une sœur ou un frère souffre d’une maladie. Celui qui souffre accapare toute l’attention des parents et des proches. En ce qui me concerne, je rentrais dans la phase de puberté et cela ne m’a pas aidée pour me construire. J’avais l’impression de n’être qu’une remplaçante mise sur le banc de touche frustrée de ne pas pouvoir participer au match en tant que titulaire. Parfois, je faisais des entrées remarquées sur le terrain pour taper fort dans le ballon, avant de me retrancher dans mon coin pour reprendre mon poste de spectatrice impuissante. Je trouvais qu’on ne s’intéressait pas assez aux difficultés rencontrées par la fratrie. Toutefois, il est vrai aussi que je n’ai pas exprimé ma souffrance, ne voulant pas causer davantage de soucis à mes parents. Le fait qu’on ne me disait pas tout a contribué à renforcer cette sensation de rejet. Sans vouloir me l’avouer, j’en voulais à ma sœur et à mes parents.
Puis, je suis tombée moi-même malade, et j’ai compris. Qu’elle n’avait jamais voulu me prendre ma place.
Puis, je suis moi-même devenue mère, et j’ai compris. Qu’ils avaient trimé pendant toutes ces années pour aider ma sœur sans jamais m’oublier. Qu’ils m’avaient épargnée de certains faits terribles à entendre dans le seul et unique but de me protéger et non pas pour me mettre de côté.
À la suite du décès de ma grande-sœur, le spectre de la fusion a dangereusement rodé au-dessus de nos têtes. Mes parents m’ont beaucoup investie. Lorsque le désir d’indépendance m’a brutalement saisie, je me suis sentie étouffée par la situation. Je voulais qu’ils m’aiment pour qui j’étais et non pas pour combler l’absence de ma sœur. Je leur ai demandé de me laisser m’épanouir parce que je n’aurais pas pu devenir une adulte responsable avec eux constamment à mes côtés pour vérifier que tout allait bien. Ils ont été déboussolés par ma réaction (d’autant plus que je pouvais m’exprimer abruptement) et à raison. J’étais tiraillée entre le souci de leur bien-être et mon envie de voler de mes propres ailes. Je réalisais enfin que j’avais une vie à mener, la mienne, en dehors du prisme familial.
Quant à ma grande-sœur, son souvenir me poursuivait. Si je n’allais pas bien, je me disais, c’est parce qu’elle n’est plus là. Certes, mais il n’y avait pas que ça. Il fallait que j’arrête de rattacher toutes mes difficultés à elle. J’ai voulu m’affranchir de ce passé douloureux et envahissant. J’ai pensé que tourner la page suffirait. Na na na. Si seulement. Un boomerang lancé loin derrière soi n’y restera pas très longtemps. Au bout d’un moment, il finit forcément par revenir à l’envoyeur, et le choc peut être terrible. J’en suis tombée malade. Et j’ai eu peur. Je l’avais vue en pleine crise de psychose, et j’ai eu peur de décrocher le pied de la réalité à mon tour. J’avais vu l’effet qu’ont exercé les médicaments sur elle, et j’ai eu peur de subir la même chose. Je l’avais vue mourir, et j’ai eu peur de mourir, moi aussi.
Deux ans plus tard, j’entretiens une relation beaucoup plus saine avec mes parents. Si nous restons très proches et si nous baignons toujours dans une mer d’affection, nous avons cessé de nous confondre les uns dans les autres. L’attachement est une chose, la fusion en est une autre. Je suis et je serai toujours leur fille, mais ce n’est plus l’identité qui me définit principalement. Par la force des choses, je parviens à me positionner d’une manière plus posée. J’ai cessé de m’excuser d’avoir une opinion différente de la leur, et ça, c’est déjà un énorme pas en avant. Enfin, je leur rappelle régulièrement de ne pas s’oublier vis-à-vis de moi et d’agir selon leurs propres désirs.
Deux ans plus tard, ma sœur m’accompagne dans ma vie au quotidien, non plus comme un fantôme qui me hante mais comme une source inépuisable de lumière qui éclaire mon chemin. Avant, nous étions reliées par un fil. À présent, nous évoluons côte à côte, même si nous ne pouvons plus nous voir. Parfois, nous nous prenons la main, mais pas tout le temps. Nous ne sommes plus deux en une ni une en deux, mais deux êtres à part entière qui se sont tant aimées et qui continueront à s’aimer au-delà de la mort.
À nous quatre.