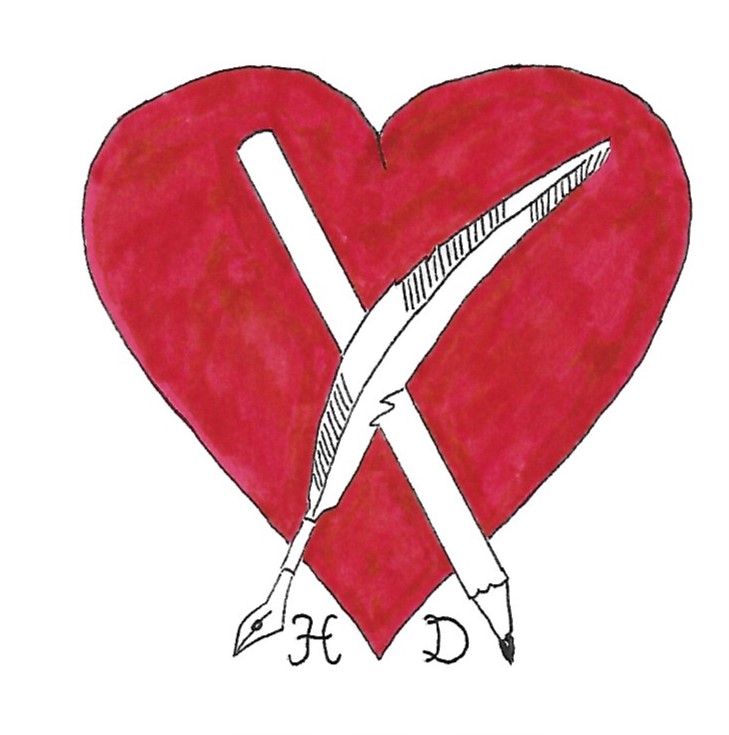14 Oct Ça ne se voit pas, chez vous

« On ne demande à personne de se justifier d’avoir une grippe. Alors, si l’on vous dit, « ça ne se voit pas, chez vous », ne percevez pas ces mots comme une attaque qui vous désarçonnerait, face à laquelle vous bâteriez en retraite ou vous seriez forcé à répondre. Oui, ça ne se voit pas. Et alors ? C’est un fait. Ne cherchez pas à le prouver, car il l’est déjà, tout du moins pour vous, vos proches et les professionnels de la santé qui vous accompagnent dans votre combat.«
Question : que voyez-vous sur cette image ?
Réponse : facile. Une femme souriante.
Questions complémentaires : parvenez-vous à percevoir son mal-être ? L’indésirable douleur qu’elle éprouve dans le haut de son corps et partout ailleurs ? Ses difficultés à respirer correctement ?
Réponse : …
C’est là que la tâche se complique. Si je n’étais pas elle, si elle n’était pas moi, je n’aurais rien deviné.
Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu cette phrase. « Ça ne se voit pas, chez vous ». Même si elle n’était pas prononcée à mauvais escient, elle me faisait systématiquement avaler une bouffée d’angoisse. Tels des flèches empoisonnées, ces sept mots instillaient un venin redoutable dans mon système de pensées, le poussant irrémédiablement à se défendre, ou plutôt à contrattaquer. Avec un minimum de confiance en soi, la réponse serait bien plus lacunaire.
La personne en face : ça ne se voit pas, chez vous !
Moi (confiante) : que voulez-vous, c’est ainsi.
Moi (en vrai) : je ne suis vraiment pas bien vous savez. Parler me fatigue, je n’ai presque plus envie de rien, je pleure pour un rien et quand ça arrive, les larmes s’écoulent si violemment qu’une épine scinde mon cœur en deux et le pourrit jusqu’aux dents.
La personne en face : c’est terrible ce que vous dites. Je suis désolé pour vous. Pourquoi ne pas rester chez vous ? C’est ce qu’on fait quand on est malade.
Quand on a la grippe, oui. La dépression, non. Pourquoi ? Parce que guérir de cette affection de l’âme passe par un dépassement de ses peurs pour se reconnecter à la vie, un défi titanesque qui appelle des efforts constants ; sortir, notamment. Si se confiner à l’intérieur apporte le repos nécessaire et un sentiment de protection bienvenu, faire un pas en dehors, c’est comme plonger dans un grand bain avec l’appréhension de se noyer pour se rendre compte qu’au bout du compte, on se retrouve à nager, grâce, notamment, à l’aide de notre entourage. Certes, difficilement au début, car tout est à réapprendre. Mais, plus tard, à force de persévérance, on savoure la récompense qui nous est donnée.
La première fois que je suis sortie de chez moi, je restais sur mes gardes en permanence, je voyais partout une animosité qui n’existait pas, je croisais mes bras sur mon cœur pour me protéger d’assaillants imaginaires, je craignais de me faire écraser à tout moment. Le monde n’avait pas changé mais la perception que j’en avais, si. Je me sentais aussi vulnérable qu’une fourmi qui se bat pour sa survie alors qu’elle arpente les pavés d’un milieu urbain qui lui est hostile.
Si j’ai toujours appréhendé le regard des autres, la dépression a décuplé ce sentiment. Paradoxalement, alors que je faisais tout pour que ça ne se voie pas, en maquillant mon sourire et parfois mon visage, quand j’entendais dire « ça ne se voit pas », je sortais de mes gonds. Les doutes s’immisçaient dans chaque lobe de mon cerveau pour me qualifier d’imposture, d’une fraude qui n’est pas réellement malade, qui, à la place, a décidé de s’arrêter pour faire une pause et prendre du bon temps. Affublée d’un nuage noir invisible au-dessus de ma tête, j’étais atteinte d’une maladie insaisissable aux yeux des autres. Si j’avais reconnu mon mal-être, je ne l’assumais pas et, forcément, il m’arrivait de le remettre en cause, rongée par une culpabilité qui me dépassait. En toute logique, parée de mon bouclier en fer forgé, je fuyais les interactions sociales.
On enrage d’être des incompris. Lorsque l’on me suggérait de lâcher prise, sortir de ma zone de confort, voir mes amis, faire des choses que j’aime, regarder tout ce que j’ai autour de moi, de profiter du présent car c’est si facile d’être heureuse et que le spleen c’est has-been, de tout oublier pour y croire, car le passé c’est le passé, je m’énervais. Ces conseils prodigués en toute bonne volonté hérissaient mon système nerveux.
Avec le recul, j’ai compris à quel point il était difficile de comprendre, que la dépression, faite de hauts et de bas, ne maintient pas constamment au fond du trou, que les tourments qu’elle inflige à ceux qui en pâtissent ne peuvent pas être passés au scanner, et que, pour s’en séparer, même si ça fout une frousse pas possible, il devient vital, à un moment ou à un autre, de se lancer, de sauter à pieds joints dans la mouise en sachant que la tempête va bien finir par se calmer. Je le comprends car, adolescente, je ne me privais pas dire à ma sœur de manger, car je pensais que ça règlerait tous ses problèmes, et que, finalement, ce n’était pas si compliqué.
Si j’avais un conseil à donner :
On ne demande à personne de se justifier d’avoir une grippe. Alors, si l’on vous dit, « ça ne se voit pas, chez vous », ne percevez pas ces mots comme une attaque qui vous désarçonnerait, face à laquelle vous bâteriez en retraite ou vous seriez forcé à répondre. Oui, ça ne se voit pas. Et alors ? C’est un fait. Ne cherchez pas à le prouver, car il l’est déjà, tout du moins pour vous, vos proches et les professionnels de la santé qui vous accompagnent dans votre combat.