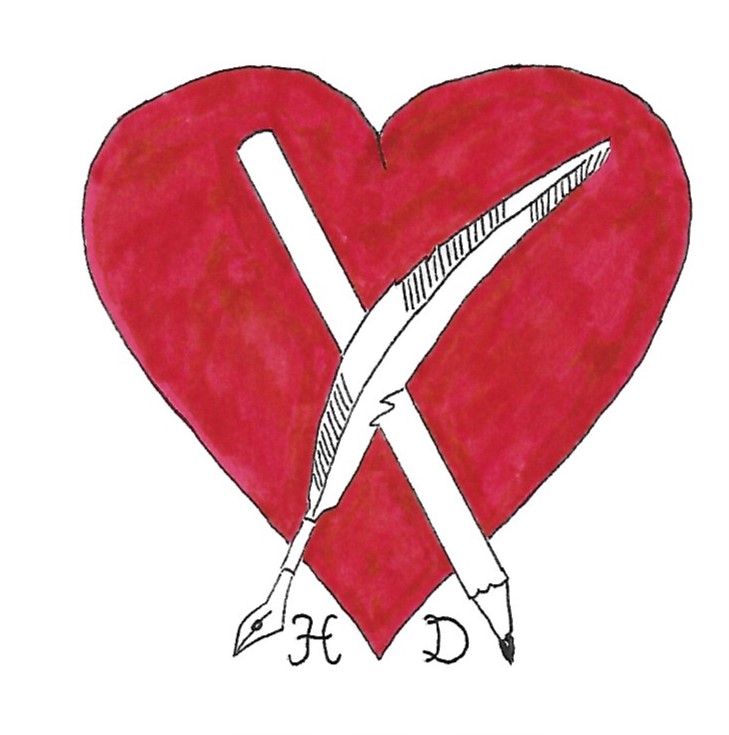24 Oct Personne ne devrait avoir honte d’être malade

« Quand la dépression est entrée dans l’équation, j’ai eu beaucoup de mal à en parler. Au lieu de dire, « je ne peux plus travailler car j’ai une dépression », je déclarais « je suis en pause avec mon travail pour des soucis de santé… liés à… ce qui se passe en moi », en désignant furtivement ma tête. Comme si, en disant le Mot, je craignais que les uns et les autres me fuient, effrayés à l’idée de faire face à une « folle » qui pourrait les contaminer ou à un mal invisible qui pourrait s’emparer d’eux à tout moment. «
Quand il m’arrive de me présenter à un individu ou de donner des nouvelles à quelqu’un après un long moment d’absence, je n’ai aucun problème à parler de ma dépression. Lorsque la situation se présente, il arrive régulièrement que mon interlocuteur manifeste un sentiment de gêne, perceptible par la tension qui s’imprime sur les traits de son visage et la désolation qui se lit dans son regard. C’est normal, parce qu’il ne sait pas quoi dire. S’il n’a pas été confronté de près ou de loin à cette maladie, il est extrêmement difficile de comprendre de quoi il s’agit. Autant vous dire qu’il m’a fallu beaucoup de temps avant de réussir à en parler librement autour de moi.
Oui, la façon dont on parle de la dépression se met à changer, et dans le bon sens. Mais elle reste un tabou et, pour beaucoup, une réalité étouffée par peur d’être « mal vu » par le reste de la société.
Vous m’auriez demandé il y a quelques années de vous expliquer comment je perçois cette maladie, j’aurais sûrement répondu : « la dépression, c’est une vie de tristesse et de mélancolie colorée en noir. » Ce mot me faisait peur car je l’associais à la décrépitude et à la mort. Et, comme tout trouble mental dépeint dans l’imaginaire collectif, à la folie. J’étais persuadée que je ne pouvais pas être touchée car j’avais depuis toujours évolué dans un insubmersible inattaquable. J’ignorais que, au contraire, c’était précisément ma fâcheuse tendance à tout garder qui allait embrayer le début de la fin.
Durant les huit années qui se sont écoulées entre mon arrivée à Bruxelles (quatre mois après le décès de ma sœur) et mon premier jour de congé maladie, mon état émotionnel empruntait déjà un sentier tortueux. Il m’arrivait souvent de pleurer sans raison apparente. M’endormir seule à la maison réveillait en moi des peurs très intenses. À l’occasion de mes nombreux réveils nocturnes, l’angoisse me saisissait alors que j’imaginais le fantôme de ma sœur derrière moi. Parfois, des pensées destructrices me faisaient voir des images violentes. Il m’arrivait aussi de m’énerver pour un rien.
Au travail, je m’activais en permanence dans le souci constant de bien faire. À la moindre erreur ou plutôt dès que j’imaginais avoir fait une erreur, l’anxiété prenait ses aises, grignotant tout l’espace sans laisser de place à la sérénité. Mais je ne voulais pas perdre la face. Celles et ceux qui m’ont côtoyée au Parlement européen vous le confirmeront : l’image que je renvoyais était celle d’une jeune femme au sourire permanent et qui respirait la joie de vivre. Mes années de théâtre m’ont aidée à entretenir la façade. Car la réalité était tout autre. Ni vu ni reconnu, l’abcès se nourrissait de mes émotions négatives, telle une bête vorace qui me grignotait à petit feu.
Puis, à cause de mes soucis de sommeil, un médicament pour mieux dormir m’a été prescrit, sans que l’on me dise de quoi il s’agissait. Je l’ai découvert en parcourant la notice. J’avais entre mes mains un antidépresseur sédatif. Je me souviens de la panique aussitôt refoulée que j’ai ressentie ce jour-là. Par la suite, j’ai décidé de ne pas interroger le médecin. Je n’en ai parlé à personne. Dans ma tête, il était tout simplement impossible que je souffre d’un état dépressif. Je me croyais forte et je souhaitais le rester.
Les années ont passé et le bagage que je transportais s’est alourdi davantage, jusqu’à ce que la pression qu’il exerce sur mon être implorant devienne insupportable. La dé-pression s’est déclenchée sans que je ne puisse lui opposer de résistance. Affolés, mon cœur et mon corps s’étaient ligués contre moi en me privant de repos, pour me mettre devant le fait accompli. Impossible de préserver les apparences, ou alors je n’aurais pas tenu longtemps avant de finir à l’hôpital. J’allais mal.
Mon cœur : depuis la mort de Maryline, tu ne t’es jamais octroyée de moment pour réfléchir sur ce qui s’est passé et pour faire ton deuil.
Mon corps : quand tu penses à ta sœur, tu me fais trembler de peur et de douleur.
Mon cœur : et tu me fais interpréter un solo diaboliquement cadencé.
Mon corps : ta colère nous malmène et ta tristesse me fait vaciller de l’intérieur. J’ai du mal à me tenir droit. Tes épaules se sont mises en grève d’ailleurs. Regarde-toi dans la glace et observe comment elles se relèvent. Tu les charges trop de tensions, voilà pourquoi.
Mon cœur : nos revendications sont claires. « Finies les tensions ! », « non à l’oppression ! », « halte à la suffocation ! ».
Mon corps : tu n’as pas voulu nous écouter, pourtant cela fait un long moment que nous te mettons la puce à l’oreille.
Moi : pourriez-vous au moins m’aider à respirer calmement, même pour quelques minutes ? J’ignore comment je pourrais supporter ces palpitations incessantes une minute de plus.
Mon cœur : c’est trop tard !
Mon corps : il fallait y réfléchir avant !
Moi : mais… comment je vais faire ? Je ne peux vivre tout le temps comme ça !
Mon cœur : il n’y a qu’une seule solution.
Mon corps : arrête-toi. Tout va se relâcher.
Moi : et si j’explose en plein vol ?
Mon cœur et mon corps, en chœur : ne t’inquiète pas, on sera là pour toi.
Mon corps : on s’accrochera tous les trois.
Mon cœur : on a de la chance aussi, d’être si bien entourés.
Moi : j’ai peur.
Mon corps (me propulsant en avant) : ça va secouer, mais ça vaut le coup. Viens, on rentre à la maison maintenant.
Quand la dépression est entrée dans l’équation, j’ai eu beaucoup de mal à en parler. Au lieu de dire, « je ne peux plus travailler car j’ai une dépression », je déclarais « je suis en pause avec mon travail pour des soucis de santé… liés à… ce qui se passe en moi », en désignant furtivement ma tête. Comme si, en disant le Mot, je craignais que les uns et les autres me fuient, effrayés à l’idée de faire face à une « folle » qui pourrait les contaminer ou à un mal invisible qui pourrait s’emparer d’eux à tout moment.
Si la dépression peut toucher n’importe qui, elle n’est pas contagieuse. C’est une maladie évolutive aux multiples facettes, si complexe à saisir car elle prend racine dans une multitude de causes qui la rendent tout sauf linéaire. Elle ne correspond pas, comme on pourrait l’imaginer, à un simple état de mélancolie prolongé. Derrière elle se cache l’amorce d’une crise existentielle d’envergure dont celles et ceux qui en reviennent ressortent systématiquement grandis. Oui, et c’est un terrible état de fait, certains n’en reviennent pas. Ne les oublions pas.
À celles et ceux qui vivent ou ont vécu une dépression, n’ayez pas honte. Si besoin est, n’hésitez pas à la nommer car, ce faisant, vous vous départirez de cet embarras qu’elle vous suscite et qui, en soi, ne fait que la renforcer. On ne devrait pas avoir honte d’être malade. Et, n’oubliez pas, vous ne l’avez pas choisie. Personne ne choisit sa maladie.