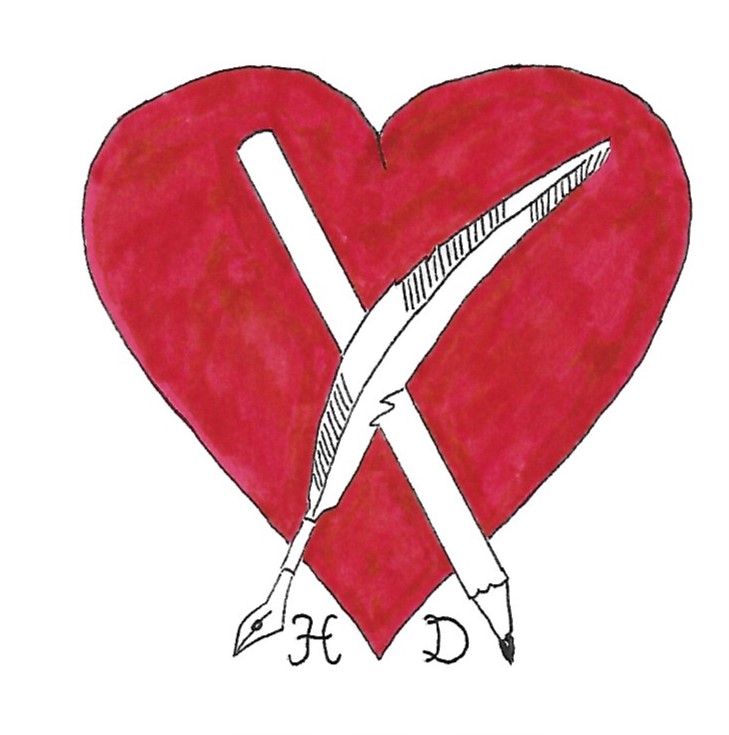13 Nov Ouvre ces bras qu’il me tarde de voir

« C’est qui ça Maman ? C’est Madame Non ? ». Telle a été la réaction de ma fille quand elle a vu mon dessin. Elle avait tout compris. Cette jeune femme, les bras croisés contre son corps, dit non à la vie. Par peur des autres et du monde qui l’entoure, elle se referme sur elle-même. Je le sais bien puisque j’ai souvent adopté cette posture.
Quand je croisais des passants dans la rue, lorsque je devais patienter pour régler des achats ou des formalités administratives, mais plus généralement dès que je sortais de chez moi, mes mains s’agrippaient à mes biceps. Si nous étions invités, je répondais sans grand enthousiasme, non pas parce que nos hôtes m’étaient désagréables mais parce que je craignais de n’avoir rien à leur dire d’intéressant ou, pire, d’avoir à socialiser avec leurs amis que je ne connaissais pas. Lors de telles occasions, mes bras se repliaient systématiquement, comme par instinct de protection d’un mal qui prenait racine dans ma tête et nulle part ailleurs. L’angoisse montait et rendait difficilement supportable un moment supposé agréable.
J’étais tellement recentrée sur ma personne qu’il ne restait plus de place pour les autres. Ma capacité d’écoute, intimement lié à ma concentration qui se dégradait, s’en est retrouvée sérieusement altérée. Et c’était normal. J’en avais trop sur mon assiette que cela en devenait indigeste, comme une poêlée surchargée d’ingrédients. Il m’était impossible de rouvrir mes bras en grand, de sortir de cet œuf protecteur et de me reconnecter à la vie sans commencer à me libérer de ce poids envahissant.
Les premiers mois, je n’ai pas vu grand monde. Quant à celles et ceux à qui je parlais, en vrai ou par téléphone, ils étaient surtout en train de m’écouter. S’ils osaient partager avec moi leurs soucis, ils n’allaient jamais bien loin car j’accordais aux miens plus d’importance, et tu comprends, je suis malade moi quand même, tu dors mal, je veux bien, mais ce n’est pas pareil, tu ne fais pas des insomnies depuis des années toi. Sous-entendu, comment oses-tu dire que ça ne va pas ? Grâce à une amie qui m’a alertée à ce sujet – sur le moment, cela n’a pas été très agréable à entendre, mais avec le recul, je ne la remercierai jamais assez de m’avoir dit la vérité ce jour-là – j’ai évolué dans mon comportement. Et la situation que j’avais vécue avec ma sœur m’estrevenue en effet miroir : toutes ces années, j’avais l’impression qu’on me niait le droit d’avoir mal parce qu’elle était malade. Eh bien, de la même façon, ce n’était pas parce que j’étais malade que les autres n’avaient pas le droit d’aller mal, eux aussi. Une telle réalisation m’a permis d’être beaucoup plus réceptive envers mes proches. Je trouvais aussi un certain réconfort à les aider (j’en reparlerai dans un prochain article).
Quant aux grandes occasions ou réunions en plus petit comité, je les fuyais pour deux raisons. D’un côté, j’avais peur d’être d’un ennui total pour les autres. Vu que je me plaçais uniquement de mon point de vue, je me disais que si des silences hachaient les discussions, c’était nécessairement ma faute. Pourquoi serais-je davantage inintéressante que mon voisin ? Pourquoi, s’il fait grise mine, serais-je automatiquement responsable ? Pourquoi, si personne ne trouve quelque chose à dire, serait-il ma responsabilité de raviver le courant ? J’ai beau avoir creusé, je ne peux toujours pas vous fournir d’éléments de réponse. Ce que je sais, c’est que si j’agissais ainsi, c’était parce que je ne m’accordais aucune valeur et que je pensais que tout tournait autour de moi, surtout quand il s’agissait de choses négatives.
D’un autre côté, me retrouver avec du monde était devenu une nouvelle source d’angoisse. Le simple fait d’être entourée de personnes, le volume sonore qui en résultait, les conversations à suivre dans un sens et dans l’autre et dont les mots m’échappaient, rimaient avec un sentiment indélogeable d’oppression rampante. Mes sens en éveil maximal ne me laissaient aucun répit. Avec ma sensibilité exacerbée, je percevais la moindre variation dans mon environnement. Un bruit entêtant pouvait m’agacer dans des proportions inconsidérées. Quand il arrivait que des malaises s’instillent dans l’atmosphère, ils restaient coincés dans les mailles du tricot de mon âme. Quant aux émotions des autres, elles ne résistaient pas à la capacité ultra-absorbante de mon éponge. Cela m’épuisait. Étais-je devenu hypersensible ou alors ce trait de ma personnalité était-il enfin en train de percer à la lumière du jour ? Je crois que je l’avais toujours été et que j’étais seulement en train de le reconnaître.
Je me souviens de ce jour où j’ai frôlé l’attaque de panique dans un bus bondé. Une petite fille assise à côté de moi faisait des bruits avec sa bouche qui l’amusaient. Hilare, je l’étais beaucoup moins. Je réprimais une envie de scotcher ses lèvres pour ne plus les entendre gober de l’air dans une imitation douteuse d’un poisson dont le disque se serait rayé. Au lieu de mettre ce plan en action (imaginez-vous les conséquences désastreuses), je suis descendue à la hâte à l’arrêt suivant. J’ai attendu des mois avant de reprendre les transports en commun. De la même manière, j’évitais autant que possible les heures de pointe pour faire mes courses. Me confronter à des foules, n’en parlons même pas – adieu les bars bondés, les restaurants trop bruyants, les magasins surpeuplés, les salles de concert, les conférences, les promenades au parc un samedi après-midi d’été.
Si je ne suis toujours pas friande de telles activités, j’ai réussi à surmonter cette angoisse envahissante qui m’avait paralysée vis-à-vis des autres. Encore et toujours, en prenant mon temps. Il m’arrivait de me lancer des défis – aujourd’hui, va prendre un café en bas de chez toi pour écrire un peu ; prend le bus pour deux arrêts ; va t’acheter un vêtement (oui, c’était une épreuve !) ; promène-toi dans un quartier animé ; va à cette fête d’anniversaire. J’essayais et je m’arrêtais si ma poitrine se nouait ou mon souffle se faisait irrégulier. Au début, je considérais cela comme un échec, comme une preuve de mon insuffisance à relationner. Puis, au fur et à mesure, j’ai accepté que si je n’y arrivais pas, ce n’était pas grave et que cela ne m’empêcherait pas de recommencer. En me donnant une petite impulsion, certes, mais sans jamais agir contre ma volonté. À force de persévérance, j’ai acquis davantage de sérénité. En apprenant à me défaire du regard des autres, à m’apprécier et à cesser de penser que tout se rapportait à ma personne (ce passant, il râle parce que j’ai fait quelque chose de mal ; ces d’adolescents, ils rigolent parce qu’ils se moquent de moi ; cette copine, elle est de mauvaise humeur par ma faute ; au cours de cette soirée, les gens ne parlent pas parce que je les ennuie), je suis parvenue à lâcher prise.
Aussi, je me suis acceptée telle que je suis. Si j’avais besoin de m’isoler pour m’imprégner d’un calme nécessaire à l’occasion d’une réunion entre amis ou en famille, j’expliquais pourquoi. Si je répondais par la négative à une invitation, j’expliquais pourquoi. Ce n’est pas à cause de vous, bien sûr que non, c’est juste que, à ce moment précis, je n’ai pas la force de parler ou de me confronter à des gens que je ne connais pas. Personne ne m’a jugée, personne n’a trouvé rien à redire. Toutes celles et ceux qui comptent pour moi l’ont compris sans que je n’aie le besoin de leur faire un film. Les autres, ils sont juste passés en coupe-vent et ne sont pas revenus. Peu m’importe, on ne peut pas plaire à tout le monde ! Cela fait tellement de bien de ne pas chercher à sortir à tout bout de champ car, si on reste chez soi un samedi soir, « c’est la dépression assurée » (la banalisation de tels termes, j’en reparlerai par ailleurs). Cela fait tellement de bien de ne pas accumuler les contacts sur les réseaux sociaux pour se prouver qu’on est quelqu’un alors qu’on en arrive à ne plus se souvenir qui sont certains d’entre eux. Cela fait tellement de bien de ne pas exister à travers les autres mais d’exister parmi les autres. Cela fait tellement de bien de ne se concentrer que sur ce qui est bon pour soi, sur l’essentiel, sur celles et ceux dont apprécie la compagnie et surtout sur les êtres qui nous sont les plus chers.
En déliant mes bras, je me suis libérée des chaînes invisibles qui m’avaient renfermée sur moi-même. J’ai ouvert en grand la porte à mon cœur pour qu’il puisse reprendre toute la place dont il avait besoin pour s’épanouir. En s’illuminant de l’intérieur, celui-ci m’a rappelé la valeur essentielle du lien social tout en m’exhortant à le faire fleurir, parce qu’il fait partie de nous tous et parce qu’il fait de nous ce que nous sommes, des êtres débordant d’humanité et d’amour.